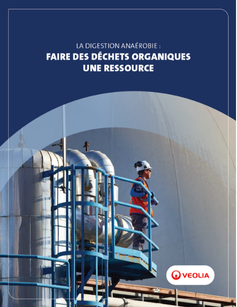Le Canada détient près de 20 % de l’approvisionnement mondial en eau douce, mais cela ne garantit pas un accès fiable ni une résilience des infrastructures. À mesure que les feux de forêt deviennent de plus en plus fréquents et intenses, ils exercent une pression supplémentaire sur les réseaux d’alimentation en eau partout dans le pays, ce qui révèle des limites en matière de capacité, de protection de la qualité et de conception des réseaux.
Cette évolution des risques incite les municipalités, les planificateurs et les opérateurs à réévaluer la structure et l’entretien des réseaux d’eau, non seulement pour répondre à la demande quotidienne, mais aussi pour faire face au stress environnemental.

L’impact des prélèvements d’eau dans les réseaux municipaux, les lacs et les rivières
La lutte contre les feux de forêt nécessite d’importants volumes d’eau, souvent puisés dans les mêmes sources que celles utilisées pour l’eau potable, l’assainissement et l’industrie. Dans les zones urbaines, la lutte contre les incendies prélève généralement l’eau dans des réservoirs, des châteaux d’eau et des réservoirs souterrains reliés à des conduites sous pression et à des bouches d’incendie.
Cette utilisation d’urgence peut exercer une pression immédiate sur les systèmes municipaux. Les prélèvements de volumes importants lors des interventions peuvent réduire la pression de l’eau, épuiser les réserves et perturber les opérations courantes telles que la distribution d’eau potable, l’assainissement et le traitement industriel. Dans les systèmes dotés d’une infrastructure vieillissante ou d’une capacité de stockage limitée, il peut en résulter des interruptions de service importantes ou la nécessité de rationner l’approvisionnement pendant et après un incendie de forêt.
Dans les petites collectivités ou les collectivités rurales, où les infrastructures officielles peuvent être limitées, la lutte contre les incendies nécessite souvent des lacs, des rivières ou des cours d’eau à proximité. L’eau peut être pompée directement à partir de ces sources naturelles, chargée dans des camions aux points d’accès ou prélevée par des hélicoptères dans le cadre d’une lutte aérienne. Bien que ces sources offrent une certaine flexibilité dans les régions isolées, leur utilisation peut nuire à la santé écologique. Un prélèvement rapide, en particulier pendant les saisons sèches, peut abaisser les niveaux d’eau, perturber la vie aquatique et perturber les habitats côtiers. Des changements soudains de température, de turbidité ou de concentration en éléments nutritifs peuvent avoir une incidence sur la qualité de l’eau, particulièrement dans les écosystèmes peu profonds ou sensibles.
Lorsque les sources d’eau de surface répondent aux besoins d’urgence et d’eau potable, cette double utilisation soulève également des questions concernant le risque de contamination, la complexité du traitement et la coordination entre les opérations de lutte contre les incendies et les services publics de distribution d’eau.
Ce que cela signifie pour la planification de l’eau : Les réseaux d’alimentation en eau doivent être conçus en tenant compte de la capacité de pointe, c’est-à-dire en équilibrant les besoins quotidiens et la demande potentielle liée à la lutte contre les incendies. Cela implique un stockage plus important, une capacité de pompage de secours, des protocoles de coordination clairs et des mesures de protection des sources d’eau afin de minimiser les perturbations écologiques.

Impact à long terme des incendies sur l’approvisionnement en eau
Au-delà de la demande immédiate, les incendies de forêt perturbent les processus naturels qui contribuent à maintenir la disponibilité de l’eau. La végétation joue un rôle clé dans la régulation du cycle de l’eau : retenir les précipitations, ralentir le ruissellement et permettre la recharge des nappes. Lorsque les forêts et les prairies sont brûlées, cette capacité tampon naturelle est perdue.
Par conséquent, les précipitations se déplacent plus rapidement, ce qui augmente l’érosion et réduit l’infiltration. Au fil du temps, cela peut contribuer à des conditions de sécheresse durables, intensifiant le cycle entre la sécheresse et les incendies. Dans les régions déjà confrontées à des pénuries saisonnières, ces changements exercent une pression supplémentaire sur les systèmes d’eau naturels et artificiels.
Ce que cela signifie pour la planification de l’eau : La restauration des bassins versants doit être considérée comme une stratégie d’infrastructure de l’eau. La protection et la replantation de la végétation dans les zones de recharge critiques contribuent à maintenir l’hydrologie locale, à ralentir l’érosion et à accroître la fiabilité des systèmes d’approvisionnement en cas de sécheresse.
Problèmes liés à la qualité de l’eau après un incendie
Après un feu de forêt, les cendres, les sédiments et les contaminants provenant de la végétation et des structures brûlées peuvent être transportés dans les rivières, les lacs et les réservoirs. Ces polluants peuvent augmenter la turbidité, introduire des nutriments qui favorisent la prolifération d’algues et transporter des métaux ou des composés synthétiques dans les sources d’eau.
Dans le cas des installations de traitement, cela pose des défis opérationnels, qui nécessitent d’apporter des ajustements aux systèmes de filtration, au dosage des produits chimiques ou à la sélection des sources. Dans certains cas, les municipalités peuvent donner l’ordre de faire bouillir l’eau ou chercher d’autres sources d’approvisionnement jusqu’à ce que le ruissellement consécutif à l’incendie s’estompe.
Les répercussions sur la qualité des eaux de surface peuvent également perturber les écosystèmes aquatiques, réduire l’accès récréatif et augmenter les coûts de traitement à long terme.
Ce que cela signifie pour la planification de l’eau : Les systèmes de traitement doivent être adaptables. Les services publics peuvent avoir besoin d’unités de traitement modulaires, d’équipement mobile ou de systèmes de filtration améliorés capables de réagir aux fluctuations de la qualité de l’eau après un incendie, ainsi que d’outils de surveillance qui avertissent rapidement en cas de ruissellement.

Conception de systèmes en fonction du stress environnemental
Les feux de forêt mettent en évidence la nécessité de disposer d’infrastructures hydrauliques capables de fonctionner en situation de stress, qu’il s’agisse de prélèvements d’urgence soudains ou de changements écologiques à long terme. Concevoir pour la résilience signifie aller au-delà des modèles de demande historiques et construire des systèmes qui peuvent maintenir le service malgré des événements imprévisibles.
Les principales considérations sont les suivantes :
- Redondance du stockage et de l’approvisionnement : augmenter le stockage sur site et sécuriser des sources secondaires pour maintenir le service pendant les opérations de lutte contre les incendies ou les interruptions.
- Protection des sources d’eau : restaurer et entretenir des bassins versants végétalisés pour réduire l’érosion et favoriser la rétention naturelle de l’eau.
- Flexibilité du traitement et surveillance : améliorer les systèmes de filtration et de surveillance pour gérer les charges de sédiments, les pics de nutriments et les contaminants chimiques après les incendies.
- Planification opérationnelle et d’urgence : coordonner les stratégies municipales de lutte contre les incendies et de gestion de l’eau, y compris déterminer les zones d’utilisation prioritaire et les points d’accès d’urgence.
Ce que cela signifie pour la planification de l’eau : La résilience est désormais un principe de conception essentiel. Les futurs systèmes doivent tenir compte de l’incertitude, grâce à la souplesse, à la redondance et à l’intégration dans des stratégies plus vastes de gestion des situations d’urgence.
Planifier en tenant compte des risques environnementaux
Alors que les incendies de forêt deviennent plus récurrents au Canada, leur interaction avec les infrastructures hydrauliques doit être prise en compte dans la planification à long terme. Les réseaux d’alimentation en eau ne sont pas seulement des services publics, ils sont des actifs essentiels en matière de résilience.
Qu’est-ce que cela signifie pour la planification de l’eau? Cela signifie que le risque d’incendie de forêt doit être explicitement pris en compte dans la planification des investissements, la modernisation des infrastructures, la gestion des bassins versants et les cadres d’intervention d’urgence. Une approche coordonnée entre les organismes et les secteurs sera essentielle pour maintenir un service fiable dans un climat en évolution.