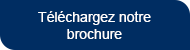Partout au Canada, une transformation silencieuse a lieu au sein des usines de fabrication. Ce qui était autrefois considéré comme une élimination courante est maintenant une priorité stratégique : le tri des déchets. En séparant les matières à la source (matières organiques, matières recyclables, déchets généraux et matières dangereuses), les principaux fabricants réduisent leurs coûts, augmentent leur efficacité et renforcent leur crédibilité en matière d’ESG. Il ne s’agit pas de s’intéresser à l’écologie pour l’image; il s’agit plutôt de mettre en place des opérations plus intelligentes qui réduisent les risques et offrent une valeur mesurable.
Cet article explore comment les installations de fabrication canadiennes transforment le tri des déchets en une stratégie de réduction des risques et de réduction des coûts, une stratégie qui améliore la conformité, soutient les objectifs ESG et préserve les résultats financiers sans investissement majeur.

Arguments économiques : pourquoi le tri des déchets est-il important?
Le tri des déchets n’est pas seulement un geste environnemental : c’est une tactique pratique et à rendement élevé qui a une incidence sur les résultats financiers, le dossier de conformité et la valeur de la marque. Pour les fabricants qui doivent composer avec des pressions sur les coûts et une réglementation complexe, les arguments économiques sont convaincants :
- Économies de coûts : lorsque différentes matières sont mélangées, elles deviennent souvent non recyclables et doivent être incinérées ou mises en décharge, deux procédés qui coûtent beaucoup plus cher que le recyclage. Par exemple, les chargements contaminés peuvent finir dans des cimenteries ou des incinérateurs, ce qui augmente les coûts d'élimination et annule les avantages environnementaux du recyclage. Un tri sélectif à la source est la solution la plus rentable et durable.
En séparant les flux de déchets à la source, les fabricants peuvent réduire les coûts d’élimination et créer de nouvelles opportunités de revenus grâce à la revente des matières recyclables triées. Lorsque des matières recyclables sont mélangées à des déchets non recyclables, l’élimination devient plus coûteuse, car l’ensemble du flux de déchets doit être traité comme non recyclable. Certaines provinces canadiennes ont instauré des taxes sur l’enfouissement ou l’incinération des déchets dangereux, rendant ainsi le tri à la source encore plus avantageux sur le plan économique. Ces frais s’accumulent, surtout lorsque les redevances de déversement et les surtaxes d’enfouissement augmentent. Bien que les installations d’enfouissement et d’incinération autorisées soient réglementées pour limiter l’impact environnemental, le tri à la source demeure la stratégie de gestion des déchets la plus rentable.
- Impact environnemental : un meilleur tri signifie davantage de matériaux réutilisés ou recyclés. Pourtant, selon Statistique Canada, seulement 27 % des déchets non résidentiels n’ont pas été mis en décharge en 2022. Le point à retenir? Il y a une marge de progression importante — et une pression — pour que l'industrie s'améliore. Par exemple, en 2021 au Québec, 144 000 tonnes (13 %) de matériaux entrants dans les centres de tri ont été rejetés en raison d’une contamination ou d’un tri inadéquat. La même année, 92 000 tonnes de verre, bien que techniquement recyclables, ont été envoyées dans des décharges. Ces chiffres mettent en évidence les conséquences concrètes d’un tri inadéquat et la nécessité urgente d'adopter de meilleures pratiques dans l'ensemble de l’industrie.
- Conformité juridique au Canada : en Ontario, les installations ICI (industrielles, commerciales et institutionnelles) sont tenues en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement de séparer les matières recyclables désignées, ce n’est pas une suggestion, mais une obligation.
Au Québec, les fabricants doivent se conformer aux règles de responsabilité élargie du producteur (REP) prévues par le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises, qui prévoit la manutention et la déclaration appropriées des matières désignées. Il est interdit de mélanger des déchets dangereux avec des déchets non dangereux afin de réduire les caractéristiques dangereuses (dilution).
En Alberta, les producteurs de déchets dangereux doivent s’enregistrer et se conformer aux règles d’élimination et de suivi énoncées dans l’Environmental Protection and Enhancement Act. Et en Colombie-Britannique, l’Environmental Management Act régit la gestion des déchets, et les règlements municipaux ajoutent souvent des obligations plus strictes en matière de tri et de déclaration.
Dans toutes les provinces, le tri sélectif des déchets n'est pas seulement une bonne pratique, c'est aussi de plus en plus une obligation réglementaire. Les établissements qui ne respectent pas ces exigences s'exposent à des amendes, à une atteinte à leur réputation ou à des mesures coercitives, tandis que ceux qui anticipent la réglementation bénéficient d'une meilleure préparation aux audits, d'une déclaration plus fluide et d'une réduction des risques liés à la responsabilité civile.
- Sécurité au travail : les déchets mélangés ou mal gérés augmentent le risque d'exposition à des substances dangereuses, de glissades, de perforations et d'autres incidents. Le tri est un outil de première ligne pour protéger les travailleurs et créer une culture de responsabilisation et d’ordre.
- Réputation de la marque : les clients et partenaires soucieux des critères ESG sont attentifs. Une étude menée par IBM en 2021 a révélé que 54 % des consommateurs seraient prêts à payer plus pour des marques écoresponsables. Les acheteurs B2B et les investisseurs utilisent de plus en plus les pratiques de gestion des déchets comme indicateur du sérieux des entreprises.

Les fabricants canadiens montrent l’exemple
Partout dans le pays, des entreprises avant-gardistes prouvent que le tri des déchets n'est pas une théorie, mais une réalité opérationnelle. Il permet de réaliser de réelles économies, offre une véritable crédibilité et fournit une feuille de route pour le reste du secteur.
Toyota Canada (Cambridge et Woodstock) maintient un taux de valorisation des déchets de plus de 90 % grâce à des systèmes avancés de recyclage, de compostage et de réutilisation , une norme qu’elle respecte depuis 2006.
Maple Leaf Foods (Mississauga) a atteint l’objectif de « zéro déchet en décharge » en investissant dans des systèmes de bacs intelligents, en offrant un formation à l’échelle de l’établissement et en établissant des partenariats avec des producteurs en aval.
Cascades (Québec) suit un modèle d’économie circulaire, récupérant plus de 1,8 million de tonnes de fibres et d’autres matières recyclables grâce à des programmes de tri et de récupération dynamiques.
GM CAMI (Ingersoll) a atteint le statut « zéro déchet en décharge » avec un taux de valorisation de 94 %, grâce à un tri rigoureux et à des processus en boucle fermée pour la réutilisation et la valorisation énergétique.
Ces exemples illustrent le pouvoir du tri des déchets lorsqu’il est mis en œuvre de façon stratégique, pas uniquement comme une obligation de conformité, mais également comme un actif opérationnel.
Innovation, tendances et soutien financier
Les stratégies actuelles de tri des déchets ne sont plus manuelles ni cloisonnées. Elles sont alimentées par la technologie, soutenues par des incitations publiques et appuyées par des pratiques exemplaires en constante évolution qui facilitent leur adoption et les rendent plus rentables.
Suivi numérique : de nouvelles plateformes de suivi des déchets et de nouveaux outils de données permettent aux installations de suivre en temps réel les volumes, les types et le statut de conformité des déchets. Cela signifie plus de contrôle, moins d’erreurs et des rapports plus rapides.
Recyclage avancé : le tri permet aux nouvelles technologies de valorisation (recyclage chimique, digestion anaérobie et valorisation énergétique des déchets) d’extraire de la valeur de ce qui serait autrement des déchets coûteux à mettre en décharge.
Soutien financier : des programmes comme l’Initiative pour une fabrication plus verte au Canada et des outils de la RPRA de l’Ontario proposent des financements, des ressources et des conseils pour aider les fabricants à moderniser leurs systèmes de gestion des déchets sans avoir à en assumer seuls l'intégralité des coûts. Au Québec, Recyc-Québec propose une multitude de programmes pour aider les installations ICI à recycler leurs déchets.

Surmonter les difficultés liées au tri des déchets
Les difficultés liées à la mise en œuvre sont réelles, mais elles peuvent être surmontées. Les obstacles courants comprennent le manque de sensibilisation du personnel, la confusion entre les poubelles, les contraintes d'espace et les coûts perçus.
Mais les entreprises qui réussissent commencent modestement et se développent intelligemment :
- Une signalisation claire et des bacs de tri avec un code de couleur réduisent les frictions et les erreurs
- Les projets pilotes dans un service, contribuent à la réussite et permettent un accompagnement
- Les vendeurs de déchets et les partenaires municipaux peuvent offrir des formations et leur expertise en matière de transport
La clé est de traiter le tri comme un investissement dans l’excellence opérationnelle à long terme et non comme un centre de coûts.
Prochaines étapes pour les fabricants canadiens
Pour les entreprises qui souhaitent des opérations plus propres, une meilleure conformité et une meilleure performance ESG, le tri des déchets est la solution la plus simple. Il ne nécessite pas de capitaux massifs. Cela nécessite du leadership, de la formation et de la cohérence.
La prochaine génération de fabricants canadiens ne se contentera pas de suivre leur empreinte carbone : ils sauront exactement où va chaque kilo de déchets, comment ils ont été triés et quelle a été la valeur créée. C’est ça l’avenir. Et ça commence par de meilleurs bacs de tri.