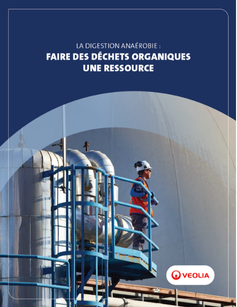Le Canada, qui abrite certains des écosystèmes les plus diversifiés au monde, se trouve à un moment critique de la lutte contre la crise mondiale de la biodiversité. Alors que le monde connaît ce que les scientifiques appellent la « sixième extinction de masse », notre nation est confrontée à des défis et à des opportunités uniques pour protéger son riche patrimoine naturel.
La gravité de cette crise a été soigneusement documentée par la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Son Rapport d’évaluation mondiale 2019 présente des preuves convaincantes d’un déclin sans précédent de la santé des espèces et des écosystèmes à l’échelle mondiale. Pour le Canada, avec ses vastes régions sauvages et ses paysages diversifiés allant des régions côtières aux forêts boréales, les répercussions sont particulièrement importantes.
Les activités humaines demeurent le principal facteur de la perte de biodiversité à l’échelle du pays. Du développement urbain à l’extraction des ressources, ces pressions menacent l’équilibre fragile de nos écosystèmes. Le maintien de la diversité des espèces, des variations génétiques et de la diversité de l’habitat est essentiel pour préserver les services écologiques nécessaires quotidiennement aux Canadiens, comme la prévention naturelle des inondations dans des villes comme Toronto et Vancouver ou la pollinisation pour notre secteur agricole.

Installations de traitement des eaux usées des municipalités : des alliés dans la création de la biodiversité
Partout au Canada, des installations municipales de traitement des eaux usées deviennent des alliés inattendus pour la préservation de la biodiversité. Ces sites, qui se trouvent dans toutes les grandes villes canadiennes et dans de nombreuses petites communauté, occupent souvent des terres importantes qui offrent des possibilités uniques d’amélioration de la biodiversité. Bon nombre de ces espaces demeurent sous-utilisés, offrant un potentiel de transformation écologique.
Des approches novatrices de gestion des installations de traitement des eaux usées sont de plus en plus utilisées partout dans le monde. Par exemple, certaines installations ont commencé à mettre en place des jardins de pollinisateurs pour les populations locales d’abeilles, essentielles pour les milieux urbains et agricoles. D’autres restaurent des zones humides, qui non seulement fournissent un habitat aux espèces indigènes, mais contribuent également à la filtration naturelle de l’eau et à la gestion des inondations. Au Canada, cela est particulièrement pertinent dans des régions comme le sud de l’Ontario et les Basses-terres continentales de la Colombie-Britannique.
La création d’habitats végétaux indigènes dans ces installations répond à de multiples objectifs. En plus de créer des sanctuaires pour la faune locale, ces initiatives aident à lutter contre les espèces invasives, qui constituent une menace importante pour la biodiversité canadienne. Les plantes indigènes nécessitent moins d’entretien et d’eau, ce qui en fait un choix rentable pour la gestion des installations tout en soutenant les écosystèmes locaux.
Ces initiatives en matière de biodiversité dans des installations de traitement des eaux usées offrent également de précieuses opportunités de participation et d’éducation des communautés. Les écoles peuvent utiliser ces sites pour des programmes d’éducation environnementale, ce qui contribue à former la prochaine génération d’ambassadeurs de l’environnement. La participation de la communauté aux programmes de plantation et de surveillance permet de sensibiliser le public et de soutenir les efforts de préservation de la biodiversité.
De plus, l’amélioration de la biodiversité dans ces installations peut mener à des solutions novatrices en matière de gestion de l’eau. Des systèmes naturels, comme des milieux humides et des fossés végétalisés, peuvent compléter les méthodes traditionnelles de traitement de l’eau tout en fournissant un habitat à diverses espèces. Cette approche a fait ses preuves dans plusieurs municipalités canadiennes, démontrant que les infrastructures et la préservation de la biodiversité peuvent être complémentaires.

Un modèle pour la biodiversité
Lorsque l’usine de traitement des eaux usées d’Okanagan Falls a ouvert ses portes en 2013 dans la vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique, les aménageurs sont allés au-delà de la conception traditionnelle en y intégrant un milieu humide. Au lieu de se fonder uniquement sur des procédés de traitement standard, ils ont créé un système naturel qui filtre l’eau grâce aux plantes et au sol des milieux humides. Cette approche s’est avérée remarquablement efficace, éliminant un tiers supplémentaire d’azote et de phosphore avant que l’eau ne se déverse dans la rivière Okanagan. Le milieu humide s’est depuis transformé en écosystème florissant, attirant des oiseaux d’eau, des oiseaux chanteurs, des amphibiens et des insectes bénéfiques, tandis que les plantes indigènes des milieux humides fleurissent le long de ses rives.
Dans un autre exemple de l’autre côté de la frontière, une usine de traitement des eaux usées du New Jersey a converti une vaste étendue d’herbe en jardins de pollinisateurs indigènes. Les jardins de pollinisateurs indigènes sont des zones paysagées spécifiquement plantées de fleurs, d’arbustes et d’autres végétaux indigènes de la région. Ces plantes nécessitent moins d’entretien, moins d’eau et moins de traitements chimiques que les espèces non indigènes. Elles fournissent également de la nourriture et un habitat aux insectes bénéfiques comme les abeilles, les papillons et d’autres espèces pollinisatrices. Enfin, cette transformation du paysage aide également à prévenir l’érosion du sol et à gérer plus efficacement le ruissellement des eaux pluviales.
Les jardins offraient d’autres avantages. En plus d’offrir des couleurs saisonnières du printemps à l’automne, l’installation du jardin a réduit la fréquence de tonte, ce qui a réduit les coûts d’entretien et amélioré la sécurité des travailleurs en supprimant la nécessité de tondre des zones potentiellement dangereuses.
Les municipalités peuvent aussi s’inspirer d’exemples dans le secteur privé. Dans une installation de fabrication de produits pharmaceutiques en Ontario, les employés ont transformé 1,4 ha de leur propriété de 16 ha en un jardin certifié pour les papillons monarques. Le projet a débuté par l’élimination d’un nerprun d’Europe envahissant et son remplacement par des arbres indigènes et un asclépiade. Au fil du temps, cette zone escarpée près du ruisseau Levi s’est transformée en une prairie de fleurs sauvages. L’équipe a amélioré l’espace en installant un hôtel à insectes afin d’offrir un abri hivernal aux espèces d’abeilles solitaires, et a obtenu la certification de la North American Butterfly Association (Association des papillons d’Amérique du Nord). Cette initiative démontre comment les propriétés industrielles peuvent transformer des terres inutilisées en habitat précieux pour la faune et soutenir la biodiversité locale tout en créant des opportunités pédagogiques pour les employés et la communauté.

Une voie à suivre : des solutions municipales pour la biodiversité
Alors que les changements climatiques continuent d’avoir des répercussions sur les écosystèmes canadiens, ces initiatives en matière de biodiversité dans des installations municipales deviennent de plus en plus importantes. Elles contribuent à la résilience climatique locale en créant des espaces verts qui aident à modérer les températures urbaines, à gérer les eaux pluviales et à offrir un refuge aux espèces qui s’adaptent aux conditions changeantes.
La transformation des installations municipales de traitement des eaux usées en havre de biodiversité représente une étape pratique et réalisable vers la résolution de la crise de la biodiversité à l’échelle locale. À mesure que les municipalités canadiennes adoptent ces pratiques, elles contribuent à élargir le réseau de sites de biodiversité urbaine, en aidant à maintenir la connectivité écologique dans des paysages de plus en plus développés.