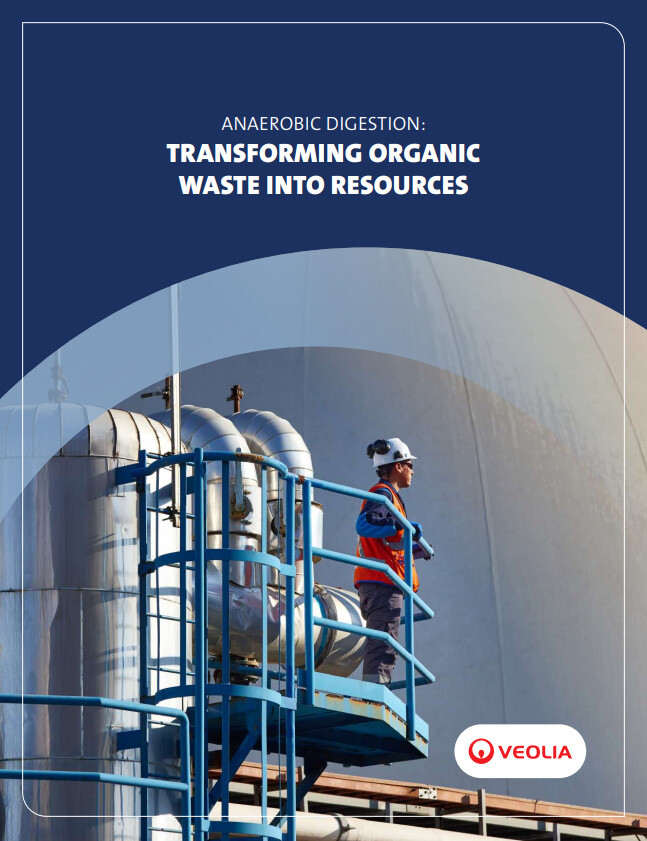La digestion anaérobie, processus par lequel les bactéries décomposent les matières organiques – déchets alimentaires, biosolides des eaux usées, fumier animal –, est de plus en plus reconnue comme une solution à la crise climatique liée à la surabondance de déchets alimentaires. Le nombre croissant d’installations de digestion anaérobie aux quatre coins du globe, et particulièrement ici au Canada, évitent l’enfouissement de déchets alimentaires pour ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) tout en créant de l’énergie verte et de précieux amendements pour les terres agricoles.
La manutention, la logistique, l’exploitation et l’entretien de ces installations sont toutefois distincts et complexes comparativement aux autres méthodes de gestion des déchets. Dans ce blogue, nous expliquons en quoi consiste la digestion anaérobie, son fonctionnement, les défis à relever et la façon dont les municipalités canadiennes contribuent peu à peu à la résolution de la crise climatique.

La digestion anaérobie au Canada
Les gouvernements provinciaux et municipaux du Canada ont banni des décharges certains déchets alimentaires organiques municipaux et commerciaux. La Nouvelle-Écosse a été la première province à interdire l’enfouissement des matières organiques en 1998, suivie de la région métropolitaine de Vancouver en 2015.
Les résidents de l’Ontario produisent environ 3,7 millions de tonnes de déchets alimentaires et organiques chaque année, et 60 % des déchets alimentaires finissent dans une décharge. La ville de Toronto lutte contre la crise climatique en s’attaquant au problème des déchets alimentaires résidentiels, avec un succès considérable. En 2014, Toronto a élargi son programme de bacs verts et construit sa deuxième installation de digestion anaérobie, la station de transfert de la route Disco.
Pourquoi est-ce si important comme mesure dans la lutte contre l’urgence climatique?
Les déchets alimentaires organiques représentent environ 30 % du flux de déchets municipaux. Dans une décharge, ils se décomposent et deviennent une source importante de méthane, un puissant gaz à effet de serre jugé environ 80 fois plus nocif pour l’atmosphère que le dioxyde de carbone. Ainsi, le détournement des matières organiques des décharges réduit les émissions de GES et préserve la capacité limitée des décharges De plus, les matières organiques envoyées à une installation de digestion anaérobie créent du biométhane, un gaz renouvelable, et de précieux produits du sol. Bref, le procédé nous permet de faire des déchets une ressource, ce qui favorise l’économie circulaire.
Les types de digestion anaérobie
La digestion anaérobie passe par des bactéries, qui transforment les déchets organiques en énergie en l’absence d’oxygène. Elle reproduit un processus naturel que l’on observe notamment dans les marais. Les microorganismes décomposent les boues au fond des marais par digestion anaérobie, ce qui génère comme sous-produits du méthane, du dioxyde de carbone et d’autres composés réduits. Pour être mis en œuvre à plus grande échelle, le procédé est optimisé à l’aide de réservoirs fermés appelés digesteurs. Les microorganismes dans les installations de digestion anaérobie digèrent la portion organique des déchets et la transforment en biogaz (biométhane), une source d’énergie renouvelable. La matière organique résiduelle forme ce qu’on appelle le digestat; celui-ci est asséché et composté pour devenir un engrais en agriculture.
Au Canada, deux types de technologies de digestion anaérobie prédominent actuellement pour le traitement des matières organiques municipales et commerciales : celles dites « humides » et celles dites « sèches ». Le choix de la technologie se fait principalement en fonction des matières premières reçues des sources municipales ou commerciales ainsi que du résultat souhaité.

Les défis du prétraitement
Un élément essentiel du processus de digestion anaérobie est le prétraitement des matières premières. En effet, lorsque la collecte des déchets alimentaires se fait dans des sacs de plastique, les matières biologiques qui les composent ont souvent une forte teneur en plastique. Le système de prétraitement élimine les contaminants inertes et les autres éléments non digestibles. Les boues organiques restantes, exemptes de contaminants, sont traitées au moyen d’un système de digestion anaérobie qui, au bout d’un certain temps, convertit les matières organiques en biogaz et en solides effluents.
Comme il existe différents types de prétraitement, il peut être complexe de choisir le bon. Tout dépend des caractéristiques des matières à traiter, des conditions particulières du site et des exigences spécifiques (p. ex. agrandissement futur, valorisation de l’énergie ou de l’eau) ainsi que des résultats souhaités.
Outre l’investissement initial en capital, il est essentiel de tenir compte à la fois des coûts d’exploitation à long terme et des revenus qui peuvent être générés par l’installation. Le choix d’une technologie inappropriée pourra être synonyme de problèmes opérationnels à long terme, d’un retrait médiocre ou inconstant de la demande chimique en oxygène (DCO) et de coûts d’exploitation élevés.

Le traitement des déchets alimentaires organiques dans les installations de traitement des eaux usées
Outre les installations de pure digestion anaérobie, les installations de traitement des eaux usées peuvent elles aussi prendre en charge les déchets alimentaires organiques. Nombre d’entre elles disposent déjà de digesteurs anaérobies; il suffit d’alimenter en matières organiques ceux qui sont sous-utilisés. C’est là une avenue particulièrement attrayante pour les municipalités qui cherchent à mettre à profit leurs infrastructures. Cette possibilité s’offre également aux collectivités voisines qui souhaitent éviter l’enfouissement de leurs déchets organiques.
Autre option pour le traitement des déchets organiques municipaux et commerciaux, l’utilisation de digesteurs sur une exploitation agricole est envisageable, mais seulement pour des volumes beaucoup plus faibles, compte tenu des contraintes réglementaires. On peut également recourir au traitement de la boue biologique artificielle (EBS), une technologie de prétraitement qui désemballe les déchets organiques dans les stations de transfert ou d’autres lieux, puis transporte les boues organiques vers une installation de traitement des eaux usées, où elles sont injectées dans les digesteurs anaérobies. Bien que ce processus qui optimise – voire remplace – le prétraitement à l’installation ait l’avantage de réduire l’empreinte et les problèmes opérationnels associés au prétraitement des flux de déchets organiques, il reste essentiel de bien effectuer le traitement préalable des boues biologiques afin d’éviter tout problème de contamination qui pourrait avoir une incidence sur la production de biogaz et le digestat.
Dans un contexte de crise climatique où la demande est à la durabilité et à l’exploitation efficace des ressources, les municipalités canadiennes investissent dans des programmes complets de traitement des déchets organiques. Ces programmes visent à tirer le maximum de valeur des déchets organiques par la compensation des coûts opérationnels, la production d’énergie renouvelable à partir de biogaz et la création de sous-produits bénéfiques pour l’agriculture, trois composants d’une économie circulaire florissante.
Ces programmes de transformation nécessitent toutefois une planification complexe et des connaissances approfondies dans de nombreux domaines, notamment la transformation des déchets alimentaires et des déchets de jardin municipaux et commerciaux, le traitement des eaux usées, la concentration des boues, les procédés thermiques, la commercialisation et la distribution des produits, l’épandage, et la récupération d’énergie.